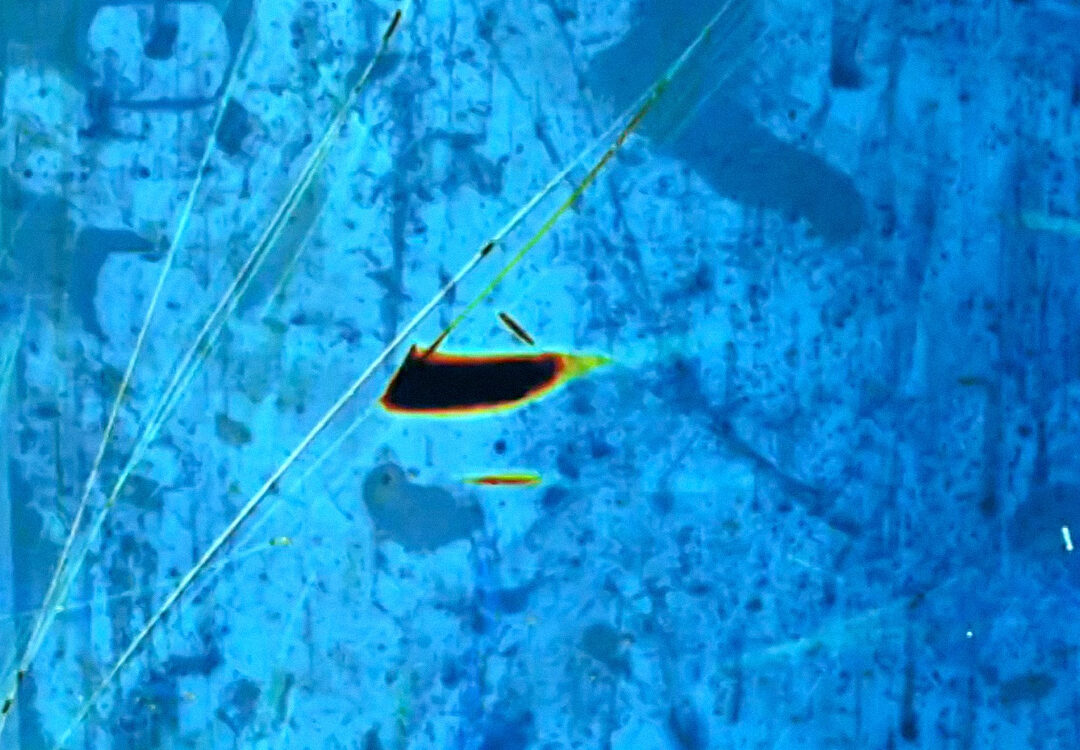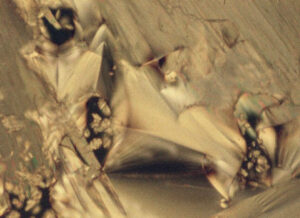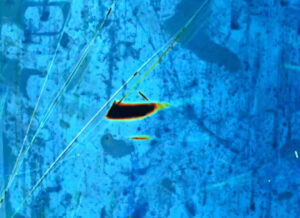Jeudi 11 décembre 2025 · 20h30
Partie I / cinéma pour l’oreille
Tristes Tropismes
de Bertrand Wolff, field recording/synthèse modulaire/percussions | 45 min

Tristes Tropismes puise son imaginaire dans l’idée de tropismes, ces mouvements instinctifs, ces orientations naturelles, presque mécaniques, qui guident les êtres vivants ou les éléments vers une direction. Le terme évoque aussi certains motifs qui se répondent, des répétitions qui s’imposent sans qu’on les contrôle vraiment. L’adjectif tristes renvoie ici à une mélancolie discrète, un certain calme contemplatif… Dans cet album, les tropismes deviennent des mouvements sonores, des façons de capter et de restituer des fragments du monde qui s’orientent les uns vers les autres. Ainsi, Tristes Tropismes devient une invitation à écouter le monde comme on lit un paysage humain avec curiosité, humilité, et une certaine tendresse pour ce qui ne résiste pas au temps.
Partie II / champs magnétiques
La Présence
de Dominique Dubosc | 1962 | France | 20 min | Muet | Projection en 16mm

C’est un monde clos tournant sur lui-même qui se déploie sans commencement ni fin. Ces gamins-là, séparés Les gestes saccadés et les regards habités par un ailleurs trahissent la fonction psychiatriques des murs blancs dont le film ne nous dit rien. Il déploie plutôt le quotidien d’enfants extraits du mutisme et de l’isolement au gré d’une caméra leur accordant un droit d’exister pleinement. Porté par la piste sonore de XXXXX, ces corps visibles sortent de l’ombre, sans jamais se donner en pleine lumière. Ils deviennent les incarnations fragiles mais pleines d’un entre—monde.
III. (Scènes de ménage)
de Alexandre Larose [extrait]| 2022 | Canada, France | 14 min | Muet | Projection en 35mm

De la main découle l’idée de poigne. Elle saisit, caresse, et accompagne l’enfant lors de ses premiers pas. Bientôt, elle devient étreinte, mais en se resserrant, elle bascule soudainement vers la fermeté masculine. Elle rassure en menant le tango, mais oppresse en contrôlant l’échange, refusant aux doigts adverses de pianoter. Lorsque les sillons se creusent entre les métacarpes et que le duvet qui les recouvre s’épaissit et grisonne, la poigne devient résistance, elle empêche l’affaissement, point d’appui sur la canne, le bras de chaise ou la rambarde de l’escalier. Elle garde pourtant en mémoire la tendresse des débuts, l’autorité adulte et la douceur fragile de l’âge, l’idée du père en quelques 27 os déployés sous un épiderme fragile. C’est ce geste, matrice conceptuelle et tactile, qui constitue la répétition centrale du troisième épisode (sobrement intitulé III.) des Scènes de ménage d’Alexandre Larose.
Le réalisateur y filme son père Jacques qui descend vers le jardin. Jacques regarde par la fenêtre, traverse la terrasse de bois occultée par une chaise, puis s’engage dans l’escalier avant de disparaître. Il rentrera plus tard pour se rasseoir sur cette même chaise, l’a-t-il jamais quittée ? L’exercice de description est absurde pour aborder le cinéma de Larose tant celui-ci se concentre sur l’insignifiant — encore dans cette série — pour faire émerger, à partir du plus petit détail, des images en arpèges qui étendent, déploient, complexifient un seul mouvement pour composer une symphonie visuelle. On ne peut décrire la technicité du travail effectué ici tant Larose est devenu maître en son propre monde, nous confrontant à une virtuosité analogique qui désarçonne jusqu’au plus aguerri des regards. Imaginez-vous le public d’un festival de cinéma expérimental, perdu à la frontière de Détroit et de Windsor, dont la moitié possède sa propre Bolex, et qui sort pourtant de la salle en se demandant « How the hell did he do that? ». Je me permettrais de caricaturer (pardonnez-moi) le procédé du cinéaste-ingénieur comme suit : pousser la surimpression à son extrême en répétant le même mouvement un nombre indéterminable de fois jusqu’à obtenir une masse de lumière qui condense temps passé, temps présent et temps à venir.
Mais ce qui trouble le plus dans III., c’est que Larose perfectionne sa pratique et parvient à faire oublier l’aspect prodigieux de son travail pour nous transmettre, dans ce qui m’apparaît être la plus aboutie de ses œuvres, la vérité d’un regard. Car le film met le celluloïd au service d’une sensibilité : la main effleure l’espace et raconte l’éventail d’émotions qu’incarne la figure du père. La fluidité imposée de la technique dit l’admiration et la colère, la mémoire de l’enfance et la peur de vieillir d’un fils filmant son reflet déformé et déformant. Je projette ici beaucoup de ma propre relation avec mon géniteur, mais ce biais interprétatif révèle, il me semble, la substance d’un film qui ne parle pas de Jacques mais de « papa », un ange monstrueux dans lequel chacun superpose ses souvenirs et ses espoirs. Larose parvient ainsi à faire ressentir les heures passées à filmer et refilmer ce père, un temps filmique mais avant tout humain qui transmet avec pudeur l’intimité d’un échange. De là naît la possibilité d’investir le film de notre propre rapport à la main paternelle. A l’issue de la projection, je regarde le ciel noir de Windsor, et j’y vois apparaître quelques phalanges tachées de tabac. L’invitation de Larose me ramène alors à l’état le plus primaire de la critique, me poussant à céder au superlatif : « Ai-je vu là l’une des plus belles lettres d’amour à un père de l’histoire du cinéma expérimental ? »
Samy Benammar, publié sur panorama-cinéma.com en Novembre 2023
I. (Scènes de ménage)
de Alexandre Larose | 2022 | Canada, France | 13 min | Muet
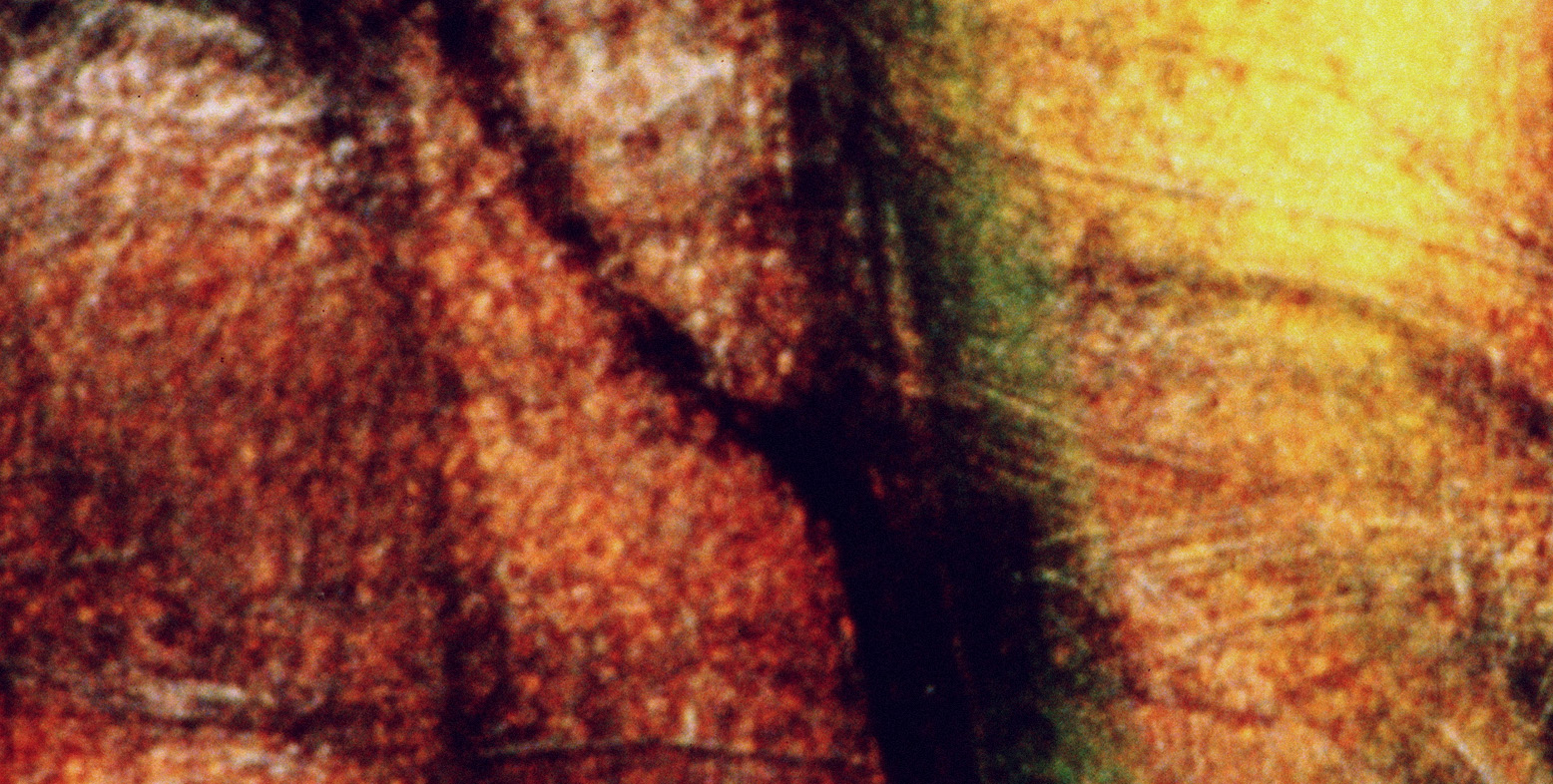
Le silence n’existe pas. Un vrombissement sourd : est-ce le sifflement du vent sur la peau ou la palpitation d’une veine contre l’oreille interne ? Plongé dans le vide, le corps émet des vibrations de chair, le tintement d’une mâchoire qui se contracte, le froissement du poumon contre la cage thoracique, la langue qui percute le palais. L’incertitude dévoile le temps. « J’ai cru entendre » fait surgir l’immédiat révolu ; une sensation est toujours saisie dans un retour sur l’instant. Les ombres émergent du présent des sens, et la conscience de leur apparition les ramène au passé.
Dans le studio des Récollets à Paris, Alexandre Larose apprivoise un espace et une lumière si éloignés du chemin de son enfance québécoise, déployé dans la série Brouillards, qu’ils en deviennent un reflet connu. Diffractées par les fenêtres de Scènes de ménage I., les cimes des arbres parisiens deviennent le lieu d’un tumulte du regard. Dans le silence d’une mémoire déplacée, celle-ci s’agite de l’obscurité à l’éclaircie, faisant apparaître une silhouette qui se confond avec les branches. Peut-être le père relève-t-il davantage du corps enveloppant les paysages, de la sensation d’une chaleur qui nous parvient au-delà des territoires, que du souvenir d’un temps et d’une maison donnés. La surimpression en caméra, écho d’une traversée répétée jusqu’à l’épuisement dans ses précédents films, dessine ici plutôt l’apprentissage tâtonnant d’une nouvelle perspective.
Y a-t-il quelque chose à entrevoir à travers ces carreaux rendus opaques par la superposition des itérations d’un même geste ? Rejoint par son père lors des trois dernières semaines de la résidence, le cinéaste lui fait reproduire la banalité de l’ouverture de ces objets qui tracent la limite entre l’espace domestique et ce qui devient, au gré de la caméra, une forme d’extériorité indomptable. Mais lorsque le corps s’approche de la liminalité, il en devient une partie, un élément de ce paysage sur lequel on projette soi et la sensation de l’autre.
J’ai cru entendre le grincement des charnières dans le grain et la couleur du Super 8, comme si ces images étaient l’incarnation d’un silence — c’est-à-dire l’impossible matérialisation de tout ce qui traverse la chair, devenue ici celluloïd. La lucarne parisienne, vision la plus banale qui soit, est investie par un refus de l’absence. Le mutisme apparent nous plonge dès lors dans le doute de l’apparition. Peut-être n’était-ce qu’une bourrasque agitant les feuilles en une silhouette familière.
Samy Benammar
Sound of a Million Insects, Light of a Thousand Stars
de Tomonari Nishikawa | 2014 | Japon | 2 min | Projection en 35mm

En enterrant 30 mètres de pellicule négative 35 mm à proximité de la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi, Tomonari Nishikawa interroge les violences résiduelles de l’accident de 2011. Les traces imprimées sur le celluloïd — rayures, microperforations et nuances de bleu — matérialisent bien plus que d’éventuelles radiations persistantes : elles révèlent les failles d’une vérité scientifique sur laquelle le gouvernement japonais s’est appuyé pour autoriser la repopulation de la zone. L’encart « The area has been decontaminated by removing surface soil and the Japanese government says that it is safe for people to return to their homes in this area » souligne cette tension entre discours officiel et réalité contestée.
Alors que l’on s’interroge sur l’origine des traces visibles sur la pellicule, c’est la manipulation politique du gouvernement qui se dévoile. Ce jeu d’échelles — entre trace physique et trace politique — se prolonge dans la dynamique qui relie le microscopique au macroscopique. À l’image de la radioactivité, qui impose de penser la matérialité depuis l’infiniment petit de l’atome jusqu’à l’infiniment grand des populations déplacées, affectées ou manipulées, la pellicule relève d’une logique de miniaturisation et d’agrandissement du réel. La lentille de la caméra capture le monde sur une surface de 8, 16 ou 35 mm de large, avant que la lentille du projecteur ne l’agrandisse pour remplir l’écran de la salle.
Au terme des 30 mètres de pellicule, Tomonari Nishikawa nous laisse ainsi entre les mondes, réduits nous aussi à l’état de corps radioactifs, de particules entre deux états : chargés des images qui viennent de défiler, mais inquiets face à l’impossibilité d’établir une vérité sur la mort et la contamination.
Samy Benammar
À propos de Bertrand Wolff
Bertrand Wolff est né en 1982 à Annecy. À la croisée des pratiques artistiques et musicales, son parcours témoigne d’une recherche constante sur les interactions entre le son, l’image et les environnements.Bertrand Wolff se forme à la musique en étudiant la clarinette et la batterie. C’est cependant sa découverte des travaux de Pierre Schaeffer, pionnier de la musique concrète, qui marque un tournant décisif dans son approche musicale. Inspiré par les explorations sonores, Bertrand Wolff s’intéresse aux nouvelles formes de composition musicale mêlant techniques instrumentales traditionnelles et outils électroniques. Après avoir étudié aux Beaux-Arts de Quimper puis de Lyon, il approfondit ses connaissances en composition au Conservatoire National à Rayonnement Régional (CNRR) de Marseille. Ces expériences nourrissent une pratique hybride où se mêlent arts visuels, musique, et technologies numériques. Compositeur et artiste sonore , il multiplie les collaborations avec des artistes issus de divers horizons : musiciens, plasticiens, écrivains, et cinéastes. Ses créations s’inscrivent dans un dialogue permanent entre le son et son environnement. En 2018, il compose Umwelt, une pièce mixte mêlant musique instrumentale et électronique, coproduite par le GMEM — Centre national de création musicale de Marseille. En 2016, il cofonde Mujô, un studio spécialisé dans la création sonore et le cinéma documentaire. Puis, avec Auscúltare, présentée lors du festival Propagations en 2023, il explore la relation mimétique entre la voix humaine et les synthèses électroniques. Bertrand Wolff se situe à la confluence de plusieurs traditions musicales, notamment la musique acousmatique, l’electronica (Postcoïtum Animal Triste avec Damien Ravnich), et la musique contemporaine. Ses compositions se caractérisent par une approche immersive, souvent destinée à envelopper l’auditeur dans une position d’écoute particulière. Il conçoit le son non seulement comme un matériau musical, mais aussi comme un vecteur d’émancipation et de réflexions.
À propos d’Alexandre Larose
Artiste de l’image en mouvement, Alexandre Larose s’intéresse à la représentation de l’espace et de la figure ainsi qu’à la manière dont la spécificité du médium cinématographique les met en mouvement.
À propos de Tomonari Nishikawa
Tomonari Nishikawa est né en 1969 au Japon. Au moment de sa disparition en 2025, il vivait à Vestal, dans l’État de New York, et enseignait au département cinéma de l’université de Binghamton, où il avait étudié le cinéma et la philosophie et commencé à faire des films. Les films de Nishikawa explorent l’idée de documenter des situations/phénomènes à travers un médium et une technique choisis, en se concentrant souvent sur le processus lui-même. Ses films ont été projetés dans de nombreux festivals et lieux d’art, dont la Berlinale, le Festival international du film d’Édimbourg, le Festival international du film de Hong Kong, le Festival international du film de Rotterdam, le Festival du film de Londres, le Media City Film Festival, le Festival du film de New York, le Festival international du film de Singapour et le Festival international du film de Toronto. En 2010, il a présenté une série de films 8 mm et 16 mm au centre d’art contemporain MoMA P.S.1, et son installation cinématographique, Building 945, a reçu le prix 2008 du Musée du cinéma contemporain en Espagne. Il a été juré au Ann Arbor Film Festival 2010, au Big Muddy Film Festival 2012 et au dresdner schmalfilmtage 2013. Il était l’un des cofondateurs de KLEX : Kuala Lumpur Experimental Film and Video Festival et Transient Visions : Festival of the Moving Image.
À propos de Samy Benammar
Samy Benammar est un cinéaste, photographe et critique d’art partagé entre Montréal et Marseille. Puisant dans ses racines algériennes et son enfance en milieu ouvrier, son travail mêle une approche documentaire réflexive à une expérimentation tactile. Il cherche ainsi une forme de réconciliation visuelle tout en soulignant les fractures irréparables laissées par les fantasmes du passé. Ses œuvres ont été présentées dans des festivals à l’international et sont distribuées par le Winnipeg Film Group, Vidéographe et le CFMDC. Il a siégé aux comités de rédaction des revues Hors Champ, 24 images et Panorama-cinéma, et poursuit actuellement un doctorat sur la photographie coloniale dans la région des Aurès, en Algérie.
À propos de MAGMA
MAGMA est un rendez-vous bi-mensuel donné au VIDEODROME 2 depuis 2021. Les film(s) projeté(s) font écho aux performances musicales qui ouvrent les séances, par associations d’idées. Prolongements, contre-pieds, télescopages, frictions, fluidités. MAGMA c’est rugissement, chant d’amour, rage de vivre, rêverie, violences du monde et leurs envers, lignes de crêtes, champs de tensions, gestes francs.
Informations pratiques
Rejoindre l’événement Facebook
La billetterie ouvre 30 minutes avant le début de chaque séance.
Nous pratiquons le prix libre (chaque personne paie ce qu’elle veut/peut/estime juste).
Nous croyons au prix libre comme possibilité pour chacun·e de vivre les expériences qui l’intéressent et de valoriser le travail accompli comme il lui paraît bienvenu. L’adhésion à l’association est nécessaire pour assister aux projections, elle est accessible à partir de 8€ et valable sur une année civile.
Il est aussi possible de prendre son adhésion en ligne ! Pour celleux qui le souhaitent et le peuvent, cette adhésion permet aussi de nous soutenir, en ajoutant un montant de son choix.
Toutes les séances MAGMA